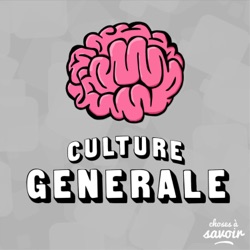Episodes
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Même si des navigateurs portugais ont pris pied, dès le début du XVIe siècle, sur cette grande île du bout du monde nommée alors "Terra Australis", les Européens ne s'intéresseront vraiment à l'Australie que deux siècles et demi plus tard.
En effet, il faudra attendre 1770 pour que le célèbre explorateur James Cook prenne possession de la plus grande partie de l'Australie au nom du Roi d'Angleterre.
Une fois à terre, les Européens découvrent avec étonnement la curieuse faune locale. Ainsi, ils sont intrigués par son représentant le plus emblématique, le kangourou, avec ses grands pieds, ses petits bras et sa poche ventrale. Les sauts de cet animal inconnu, qui deviendra le symbole de l'Australie, ne laissent pas non plus de surprendre les navigateurs.
Le nom de cet animal lui a d'ailleurs été donné par les explorateurs venus de la lointaine Europe. Mais pourquoi l'ont-ils appelé ainsi ?
Si l'on en croit la plaisante histoire qu'on raconte volontiers à ce sujet, ce nom viendrait d'un quiproquo. Descendu de son bateau, le capitaine Cook, avisant un kangourou gris, demande à un habitant rencontré sur les lieux comment s'appelle ce curieux animal.
D'après une autre version du récit, le dialogue se serait noué entre cet indigène et Joseph Banks, un naturaliste anglais participant lui aussi à l'expédition de Cook.
Quel que soit son interlocuteur, cet autochtone lui répond alors "kan ghu ru". Cook, ou Banks, pensant qu'il s'agit là du nom de l'animal, transcrit le mot entendu sous la forme écrite "kangaroo", qui donnera "kangourou" en français.
Mais il s'agirait en fait d'un malentendu. En répondant ainsi, l'aborigène ne donnait pas le nom de l'animal, il indiquait simplement ne pas comprendre ce que lui disait le capitaine.
Or, il semble que cette histoire, trop belle pour être vraie, relève de la légende. Il existe pourtant, dans les langues locales, un mot proche pour désigner le kangourou noir : le terme "gungurru".
D'autres vocables désignent cet animal sous les noms de "mee-nuah" ou encore "patagorong" ou "patagoroug".
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Episodes manquant?
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
La vie d'un citadin, cernée par le béton et soumise au bruit et à la pollution, serait moins facile que celle d'un habitant des campagnes. Le constat n'est pas nouveau.
En effet, les arbres captent en partie les polluants de l'air. Une personne vivant à proximité d'un parc pourra ainsi bénéficier d'une atmosphère plus saine. Il lui sera aussi plus facile de marcher ou de courir dans ses allées.
De tels lieux, un peu à l'écart du bruit des voitures, sont aussi plus tranquilles. Le simple fait de pouvoir contempler des arbres ou de la végétation aurait même un effet apaisant. Ce contact avec la nature atténuerait la tendance à la rumination et permettrait un véritable ressourcement.
Ainsi, des études ont montré que des salariés voyant des arbres de leurs logements étaient plus motivés au travail.
Des chercheurs espagnols ont voulu mesurer avec plus de précision cet effet bénéfique de la nature sur les citadins. Pour cela, ils ont interrogé plus de 3.000 habitants de Barcelone, âgés de 15 à 97 ans.
Ils ont cherché à savoir comment ils se sentaient, reliant notamment leur état de santé mentale avec le quartier où ils vivaient. Ils ont alors constaté que les Barcelonais se sentant le mieux dans leur vie respectaient, sans le savoir, la règle des "3-30-300".
De quoi s'agit-il ? Cette règle signifie que les citadins les moins stressés peuvent apercevoir au moins 3 arbres de leurs fenêtres, vivent dans un quartier agrémenté d'au moins 30 % d'espaces verts et habitent à moins de 300 mètres d'un parc.
Des conditions qui sont rarement réunies, du moins toutes ensemble. Ainsi, pour revenir à l'enquête déjà évoquée, seulement 5 % des Barcelonais respectaient cette règle des "3-30-300".
D'après les résultats de l'étude, ces habitants prenaient moins d'antidépresseurs et consultaient moins de psychologues ou de psychiatres que les Barcelonais privés du contact de la nature.
Pour les chercheurs, il y aurait donc bien une corrélation entre la présence d'espaces verts, à proximité du logement, et une meilleure santé mentale.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Le sens très similaire de certains mots rend leur distinction difficile. C'est l'une des difficultés du français. Ainsi confond-on souvent les mots "venimeux" et vénéneux". Ils font tous deux référence à une idée de danger et de toxicité.
Mais leur sens est pourtant légèrement différent. Comme le mot l'indique, le terme "venimeux" s'applique le plus souvent à des animaux capables d'injecter du venin à leurs victimes.
C'est notamment le cas de certaines espèces de serpents, de poissons et d'araignées, des abeilles ou encore des scorpions. Le venin est inoculé par une morsure ou une piqûre. Ces animaux l'utilisent pour chasser ou repousser les prédateurs.
Le mot "vénéneux" est plutôt employé pour des végétaux. Ainsi, un champignon vénéneux, comme l'amanite tue-mouches, contient des substances toxiques qui, une fois ingérées, peuvent entraîner de graves problèmes de santé, et même entraîner la mort.
Certaines plantes, comme la belladone ou le colchique, peuvent être également qualifiées de "vénéneuses". De même, des produits toxiques, connus pour pouvoir provoquer un empoisonnement, peuvent aussi être qualifiés de "vénéneux". On peut citer, parmi beaucoup d'autres, le mercure ou l'ammoniac.
Mais ce terme s'applique parfois aux animaux. Ce ne sont pas des animaux "venimeux", dans la mesure où ils sont incapables d'administrer, de manière active, du venin à leurs victimes.
Ce sont des animaux dont la chair contient des produits toxiques. Il serait donc dangereux de la manger. On peut notamment citer les oiseaux du genre Pitohui, dont les plumes et la peau recèlent une toxine très active. Elle leur vient des végétaux et des insectes dont ils se nourrissent.
Dans ce cas, le poison n'est pas produit par l'organisme de l'animal, mais il lui est transmis par les plantes et les insectes qu'il mange.
On le voit, si le terme "venimeux" implique, de la part des animaux concernés, une action volontaire, le mot vénéneux", en revanche, véhicule une idée de passivité. En effet, les végétaux et les rares animaux vénéneux ne sont dangereux que si on les touche ou les consomme.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Le terrible traumatisme provoqué par la Shoah et les horreurs du régime concentrationnaire nazi n'ont pas empêché certains cinéastes de s'en inspirer d'une manière particulièrement malsaine.
Ils sont à l'origine d'un genre nommé "nazisploitation" ou, de manière plus explicite, "nazi porn" ou "gestaporn". Il est illustré par de nombreux films d'exploitation, autrement dit des bandes à petit budget, tournés à la va-vite et sans préoccupations artistiques.
Ces films mettent en scène des personnages sadiques et violents, qui s'acharnent sur leurs victimes. Le cadre est souvent un camp de concentration ou une maison close.
Divers sévices, souvent à caractère sexuel, y sont complaisamment montrés, avec une violence qui confine parfois au "gore", ce genre cinématographique dans lequel le sang coule à flot.
La qualité esthétique de certains films, et la réputation de leurs auteurs, leur vaut de ne pas être rangés dans la peu glorieuse catégorie de la "nazisploitation".
Et pourtant, ils mettent en scène des histoires troubles, qui se déroulent durant la période nazie. Ainsi, le film de Luchino Visconti, "Les damnés" (1969), qui raconte les accointances d'une famille d'industriels allemands avec les nazis, montre des scènes d'orgie et de violence.
Quant au film de Liliana Cavani, "Portier de nuit" (1974), il dépeint les relations sadomasochistes qui se sont nouées entre le médecin d'un camp de concentration et une de ses anciennes détenues.
Mais la plupart des films ayant exploité cette veine ne peuvent pas invoquer le moindre caractère artistique. Leur nom même en dit assez long sur leurs ambitions.
En effet les auteurs de films comme "SS experiment camp" (1976), "Horreurs nazies, le camp des filles perdues" (1977) ou encore "Hôtel du plaisir pour SS" (1977) cherchent seulement à pimenter la violence et la pornographie de leurs histoires en les plaçant dans un cadre propice à toutes les perversions.
Et de fait, ces "œuvres" de série B, ou même Z, ont su attirer leur public, surtout dans les années 1970. En effet, le genre a fini par disparaître au cours de la décennie suivante.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Les visiteurs ne se demandent pas, en principe, s'ils ont on non le droit d'entrer dans un musée. D'où l'étonnement de ce visiteur qui s'est vu refuser l'entrée de la salle du musée d'art ancien et nouveau, en Australie, sous prétexte qu'il était un homme.
En effet, seules les femmes pouvaient pénétrer dans cette salle. De la surprise, le visiteur est passé à la colère. Et il n'a pas hésité à porter plainte contre le musée en question. Il a en effet jugé que, compte tenu du prix d'entrée, il avait le droit de visiter l'ensemble du musée.
Mais que trouve-t-on dans cette pièce réservée aux dames ?
Elle représente un bar dans lequel seules les femmes seraient admises. Il s'agissait pour l'artiste à l'origine de cette création de prendre le contre-pied des débits de boisson australiens qui, jusqu'en 1965, étaient interdits aux femmes. Ou du moins celles-ci n'avaient pas le droit d'y prendre un verre.
Le lieu que n'a pu découvrir le visiteur refoulé a été nommé "Ladies lounge". On y marche sur un sol en marbre et, au mur, sont accrochées des toiles prestigieuses, signées Picasso ou Sidney Nolan.
Les visiteuses peuvent s'asseoir sur un canapé en velours dont la forme évoque celle d'un phallus. Confortablement installées dans ce siège opulent, elles peuvent siroter une coupe de champagne apportée par des majordomes obligeants, qui filtrent aussi les visiteurs à l'entrée.
L'artiste qui a imaginé la décoration de cette salle n'est pas vraiment fâchée de cette plainte. En effet, son œuvre serait inspirée par la notion de rejet, expérimenté, en l'occurrence, par les visiteurs masculins.
Quant à l'avocate chargée par le musée de défendre ses intérêts, elle soutient qu'interdire l'entrée de cette salle aux hommes peut se justifier si cette mesure est de nature à améliorer la situation d'un groupe défavorisé, ici les femmes.
Mais la direction du musée n'exclut pas, cependant, de trouver un autre lieu pour ces œuvres si la justice exigeait que la salle soit ouverte à tous les visiteurs, hommes compris.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Devant la multiplication des radars, qui contrôlent la vitesse des véhicules, certains automobilistes équipent leurs voitures de détecteurs de radars. Ces boîtiers détectent les ondes émises par les radars et avertissent le conducteur, par un signal sonore ou visuel, de leur présence.
Mais un décret du 3 janvier 2012 interdit formellement ces dispositifs, tout comme les avertisseurs de radar. Ces derniers indiquent la présence de radars fixes ou mobiles en s'appuyant sur des données de géolocalisation.
Quant aux brouilleurs de radars, ils parviennent, comme leur nom l'indique, à perturber le fonctionnement des radars. Ce dispositif est, lui aussi, tout à fait illégal.
Les forces de l'ordre disposent d'un matériel spécifique pour détecter les détecteurs de radars. Ils sont également en mesure d'en retrouver les acheteurs en consultant des sites spécialisés.
Les contrevenants ne sont donc pas à l'abri des sanctions. En effet, ils s'exposent d'abord au paiement d'une lourde amende de 1.500 euros, doublée en cas de récidive. Par ailleurs, leur permis de conduire peut être suspendu et le véhicule immobilisé. Enfin, le conducteur fautif se voit retirer six points sur son permis de conduire.
Il existe tout de même une solution légale pour permettre aux conducteurs de repérer un radar. Il s'agit des détecteurs de radar intégrés à des assistants d'aide à la conduite.
Ce dispositif qui, comme son nom l'indique, apporte une aide à l'automobiliste tout au long de son trajet, lui signale notamment la proximité de "zones de danger". Il peut s'agir d'un accident, récemment survenu, ou d'un embouteillage.
Le conducteur est donc invité à ralentir et à se montrer vigilant. Mais si la mention "zone de danger" apparaît, ce peut être aussi en raison de la présence d'un radar.
L'assistant d'aide à la conduite n'indique donc pas avec précision, comme les dispositifs illégaux, l'emplacement du radar. Il se contente de signaler sa présence dans une zone généralement comprise entre 500 mètres et deux kilomètres.
Cet avertissement incite le conducteur à modérer sa vitesse. Et c'est bien pour cela que le dispositif a été autorisé.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Il est parfois difficile, dans une langue au lexique aussi riche que le français, de différencier certains mots. C'est le cas, par exemple, de deux mots du langage maritime que nous considérons souvent comme des synonymes.
Comment distinguer, en effet, les mots "bateau" et "navire" ? Ils nous paraissent a priori interchangeables. Et pourtant, ils n'ont pas tout à fait le même sens.
Le mot "bateau" est ce que l'on appelle un terme générique. Autrement dit, un mot employé pour désigner l'ensemble des embarcations. Ainsi, un voilier, une yole ou un paquebot sont des bateaux.
Le terme "véhicule" est un autre exemple de mot générique. Il désigne en effet tout se qui roule ou se déplace. Ainsi, une charrette est aussi bien un véhicule qu'une voiture ou un tracteur.
Pour en revenir à notre navire, c'est aussi, bien sûr, un bateau. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai.
En effet, tous les bateaux ne sont pas des navires. Et pour cause : un navire est un gros bateau, capable de voguer en pleine mer. C'est donc une question de degré, et non pas de nature. Plus imposant, le navire est donc de fort tonnage et peut atteindre les 300 ou 400 mètres de long.
Il est généralement doté de plusieurs ponts et peut embarquer, s'il s'agit d'un navire de croisière, des centaines, voire des milliers, de passagers. Ils trouvent d'ailleurs à bord des équipements de loisirs, comme des piscines ou des restaurants qui, comme on le sait, tiennent beaucoup de place.
Mais son fort tonnage lui permet aussi de transporter d'importantes cargaisons, qu'il s'agisse de pétrole ou de marchandises diverses.
Ces grands bateaux peuvent aussi filer à des vitesses appréciables. Ainsi, la vitesse moyenne d'un paquebot est de l'ordre de 25 nœuds, soit un peu plus de 45 km/h.
Même si, encore une fois, un navire est un bateau, on emploiera plutôt ce dernier terme pour désigner une embarcation de plus petite taille. Si les navires se risquent en haute mer, les bateaux préfèrent naviguer sur les fleuves ou les canaux.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Si l'on veut suivre la recette traditionnelle de la pizza, on utilisera notamment, en plus de la farine et de la levure, des tomates, de la mozzarella et du basilic. Mais aujourd'hui, on met un peu ce qu'on veut dans ce célèbre mets italien.
En effet, les restaurateurs rivalisent d'imagination. Cependant, certaines recettes surprennent plus que d'autres. C'est notamment le cas de la pizza hawaïenne.
Ajouter un fruit exotique comme l'ananas à ce plat typique de la cuisine méditerranéenne peut en effet sembler incongru à certains amateurs de pizzas. D'autres, en revanche, trouveront ce mélange sucré-salé à la fois original et savoureux.
Mais sait-on qui a eu l'idée de cette pizza hawaïenne ? Il s'agirait d'un certain Sotirios Panopoulos. Comme son nom le laisse supposer, il s'agit d'un Grec, né en 1934.
En 1954, il décide de s'installer au Canada, où il se fait appeler Sam, un prénom plus facile à utiliser dans sa nouvelle patrie. Il ouvre alors un restaurant avec ses frères.
Ils y servent notamment des burgers et des pizzas. Et un jour figure, sur le menu, la nouvelle pizza à laquelle sa composition vaudra le nom d'"hawaïenne". Nous sommes dans les années 1960. Mais comment Panopoulos en a-t-il eu l'idée ?
Interrogé à ce sujet, le cuisinier grec rappelle d'abord qu'à cette époque, au Canada, la pizza n'était pas encore un plat habituel. Les consommateurs n'étaient donc pas vraiment familiarisés avec les recettes traditionnelles.
Il était donc plus facile d'innover et d'essayer des recettes nouvelles. C'est ce que fait Sam Panopoulos. Un jour, il rentre chez lui avec une boîte d'ananas en conserve dans son sac à provisions.
Il décide d'en mettre un peu sur sa pâte à pizza. Il y ajoute du jambon et du fromage. Puis il goûte sa création et trouve le résultat succulent. Invités à la goûter, les clients plébiscitent la nouvelle pizza.
Puis il la baptise "hawaïenne" en référence à la marque de la boîte d'ananas. Depuis, son succès ne s'est pas démenti, même si, pour certains, une pizza à l'ananas n'est pas vraiment une pizza.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
La dune de Pilat est l'une des curiosités naturelles les plus visitées de France. Rien d'étonnant à cela, car c'est la dune de sable la plus haute d'Europe. Située dans le bassin d'Arcachon, elle se dresse à près de 107 mètres de hauteur.
Et large de 500 mètres, elle s'étend sur près de trois kilomètres. On comprend bien, dans ces conditions, qu'elle attire autant de visiteurs. La beauté du panorama qu'ils découvrent, une fois à son sommet, les récompense de l'effort qu'ils ont dû fournir pour y parvenir.
Mais comment cette impressionnante dune de sable s'est-elle formée ?
Le sable composant la dune du Pilat provient des rivières voisines. Charrié par de puissants courants marins, il s'est amassé à l'entrée du bassin d'Arcachon, où se dresse la dune. Une telle accumulation est d'ailleurs facilitée par l'importance du flux d'eau généré par la marée à cet endroit.
Puis les vents d'ouest, qui soufflent ici à certains moments de l'année, soulèvent le sable et le transportent sur la terre. Et s'il s'accumule, jusqu'à former des dunes, c'est qu'il ne peut aller plus loin.
En effet, la forêt des Landes forme une barrière naturelle très dense, qui empêche les grains de sable de voyager plus avant dans les terres.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la dune du Pilat n'est pas seulement formée de sable. On discerne en effet des marques sombres, qui se distinguent du sable plus clair.
Elles correspondent à d'anciens sols, que les spécialistes appellent des "paléosols". Il en existe plusieurs niveaux sur la dune du Pilat, composés de terre, mais aussi de restes de coquilles et de vestiges d'une occupation humaine. Le dernier, correspondant aux XVIIIe-XIXe siècles, s'élève à 70-80 m de hauteur.
Ces paléosols nous renseignent donc sur l'ancienneté d'un paysage naturel qui se serait formé voilà environ 6.000 ans. La dune du Pilat n'a pas d'ailleurs pas été formée d'un seul tenant, mais résulte de l'évolution de plusieurs dunes successives.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Je réponds de façon claire et directe à cette question en deux minutes !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Le fait de séparer les mots par un espace nous semble une évidence. Et pourtant il n'en a pas toujours été ainsi. Dans l'Antiquité gréco-romaine, notamment, les phrases étaient souvent écrites sans aucune séparation.
C'était l'époque de la "scriptio continua", l'"écriture continue". Les textes se présentaient donc sous la forme d'une suite de signes que rien ne venait aérer. Ni d'éventuels espaces, ni même la ponctuation, bien qu'il ait existé quelques points médians dans les manuscrits antiques.
Aussi le sens des phrases n'apparaissait pas de manière spontanée au lecteur. Pour le comprendre, il lui fallait lire à voix haute. C'est par cet exercice qu'il marquait des pauses dans le texte et le dotait d'une sorte de ponctuation orale.
Trouver la césure entre les mots, et donc saisir le sens du texte, ne pouvait vraiment se faire qu'à l'oral. Un exercice que nous avons du mal à comprendre à notre époque, où les textes sont depuis longtemps composés de mots bien séparés et où leur sens apparaît dès le stade de la lecture silencieuse.
L'usage de l'"écriture continue" perdure durant l'Antiquité tardive et le haut Moyen- Âge. Puis les choses changent à partir du VIIe siècle. À ce moment-là, en effet, des moines irlandais peinent à lire le latin serré des manuscrits antiques qu'ils copient. Et ce d'autant plus que le latin n'est plus leur seule langue.
Pour rendre la lecture, et donc la copie, plus aisées, ils commencent à séparer par des espaces les mots composant les phrases des textes. Ils adoptent aussi certains signes de ponctuation, comme la virgule.
Mais ces nouveaux usages restent cantonnés à l'Irlande et à l'ensemble du monde anglo-saxon. En effet, ils s'introduisent ailleurs avec beaucoup de lenteur. Il faudra attendre au moins le XIIe siècle pour qu'ils s'imposent partout.
Et c'est bien l'écriture de ces mots séparés par des espaces qui a introduit peu à peu la pratique de la lecture silencieuse, un usage qui nous paraît aujourd'hui aller de soi. Et qui modifie le rapport du lecteur au texte.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
-
Le Soleil tourne-t-il sur lui même ?
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/4IDKgIwGZeJVf0VLKfKQ2N?si=2e00976659d74129
Apple Podcasts:
Pourquoi le nez pique-t-il quand il fait froid ?
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/1aPqSWCp9jCzBP4Vi8pjJB?si=f9578998b5344014
Apple Podcasts:
-------------------------------
Quand on parle de déserts, on pense plutôt à des régions situées en Afrique ou en Asie. Mais il existe pourtant un authentique désert en Europe, et c'est d'ailleurs le seul du vieux continent.
Il se trouve au sud en Espagne, plus précisément en Andalousie. Ce désert de Tabernas se situe à une trentaine de kilomètres d'Almeria, chef-lieu de la province du même nom.
C'est en effet un secteur très aride, où les précipitations annuelles ne dépassent pas 15 mm, et encore dans les zones côtières. En effet, la zone est protégée, à cet égard, de l'influence de la Méditerranée. Quant à l'amplitude thermique, elle est très importante, comme souvent dans ce type de région.
En effet, la température peut descendre en-dessous de 0°C en hiver, mais grimper au-delà de 45°C en été. Il peut donc faire très chaud dans ce désert où la durée annuelle d'ensoleillement est d'environ 3.000 heures.
Cette région bien particulière possède une flore originale. Côté faune, les grenouilles des marais doivent se préserver des serpents et des aigles qui sont leurs principaux prédateurs.
Malgré ces conditions climatiques pénibles, la région attire beaucoup de visiteurs. À commencer par les réalisateurs de westerns, ou d'autres genres de films, qui trouvent là des décors naturels comparables à ceux offerts par les grands espaces américains.
Et ils apprécient d'autant plus les lieux qu'ils peuvent y travailler à moindres frais. C'est ainsi que Sergio Leone a tourné dans ce désert de Tabernas certains de ses plus célèbres films.
L'endroit a d'ailleurs de faux airs d'Hollywood. De fait, il n'a pas été baptisé pour rien le "Hollywood de l'Europe". Profitant de la publicité offerte par la venue de cinéastes prestigieux, d'habiles promoteurs ont construit sur place un vaste parc d'attraction inspiré par l'Ouest américain, celui des pionniers et des cowboys.
Les habitants de la province soutiennent d'ailleurs des activités qui ne peuvent que profiter à l'économie locale. Ils souhaiteraient même leur développement, pour essayer d'enrayer des maux chroniques : le chômage et la migration vers les villes.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
- Montre plus