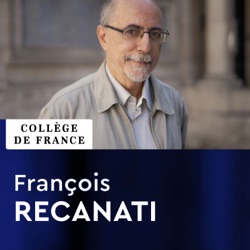Episoder
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Séminaire - Anouch Bourmayan : L'affect dans la langue : une dimension sous-évaluée ?
Anouch Bourmayan
Sorbonne Université
Résumé
Largement négligé dans le courant du XXe siècle, l'affect est progressivement réhabilité vers la fin du siècle par certains travaux en psychologie : Zajonc (1980, 2000) défend notamment l'idée que l'affect peut intervenir dans le traitement des stimuli à un niveau très précoce, qualifié de « précognitif ». En linguistique, le paradigme vériconditionnaliste s'inscrivant dans la tradition frégéenne associe le sens d'une phrase à ses conditions de vérité – un modèle dans lequel la connotation affective n'a pas sa place. Certes, depuis quelques années, les travaux se sont multipliés sur des termes ou expressions permettant aux locutrices et locuteurs de véhiculer leurs sentiments, tels les interjections, les expressifs, les insultes... Mais la dimension affective ne concerne-t-elle vraiment qu'une partie réduite du lexique ? N'est-elle pas au contraire pertinente pour la majorité des mots ? De fait, certains travaux récents en psychologie et neurosciences suggèrent qu'en langue, l'affect pourrait être cognitivement premier par rapport à l'information purement référentielle. Dès lors, quel est le statut linguistique et communicationnel de la connotation affective ? S'il convient de distinguer la connotation affective encodée linguistiquement et la connotation affective encodée culturellement, nous verrons que chacune emprunte des traits aux contenus présupposés ainsi qu'aux implicatures conventionnelles, sans qu'aucune ne se rapporte cependant entièrement à ces deux catégories. La connotation affective doit bel et bien être considérée comme un niveau de contenu spécifique, avec ses caractéristiques propres.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
06 - La structure des contenus mentaux : Force et contenu
Résumé
La thèse selon laquelle le contenu du jugement est constitué par l'acte mental consistant à attribuer à quelque chose (le sujet) une propriété (le prédicat) se heurte à deux objections. La première est l'existence putative de contenus de jugement simples (à un terme) ; la deuxième est la distinction force/contenu qui empêche de faire de l'acte d'affirmation un élément constitutif du contenu. On montre que, sur ces questions, il y a en fait quatre positions possibles, selon qu'on admet ou non l'existence de contenus de jugement simples, et selon qu'on admet ou non que les contenus de pensée sont intrinsèquement assertoriques. Ces positions sont associées respectivement à Aristote, à Brentano, à Frege et à Spinoza.
-
Manglende episoder?
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Séminaire - Louis Rouillé : Quand la fiction déraille : le cas des métafictions littéraires
Louis Rouillé
FNRS/Université de Liège
Résumé
Les « métafictions » trahissent leur propre fictionnalité en un certain sens qu'il s'agit d'expliquer. Le terme est souvent associé aux fictions dites « postmodernes », mais le phénomène existe depuis qu'il y a des fictions et il est conceptuellement indépendant de tout courant littéraire. On peut les définir abstraitement comme des fictions « narcissiques » (Hutcheon 1980 « Narcissistic Narrative: the Metaphysical Paradox »), ou « réflexives » (Friend 2007 « Fictional Characters »). Cette trahison réflexive (ou « transgression » pour réutiliser un terme cher à Genette et ses lecteurs/lectrices) montre qu'une métafiction est une fiction dont le but recherché est de dysfonctionner. Les métafictions font dérailler la structure fictionnelle normale, qu'elles présupposent donc. Ce faisant, elles attirent l'attention des lecteurs/lectrices sur l'édifice fictionnel, le rendant instable, déclenchant un effet esthétique très caractéristique. Ainsi, une figure métafictionnelle paradigmatique consiste à mettre en scène la rencontre entre un personnage et son auteur/autrice (cf., par exemple, « Niebla » 1915 de Miguel de Unamuno ; « A Breakfast of Champions » 1973 de Kurt Vonnegut ; « The People of Paper » 2005 de Salvador Plascencia). Ce genre de « métalepse ontologique » (Nelles 1997 « Frameworks. Narrative Levels and Embedded Narratives »), dont l'intérêt littéraire et philosophique n'est plus à démontrer, constituera un cas d'étude.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
05 - La structure des contenus mentaux : La distinction mode/contenu
Résumé
Selon la théorie des situations, tout jugement porte sur une situation qu'il « concerne » et relativement à laquelle on peut l'évaluer comme vrai ou faux. Cette situation joue le rôle de thème externe. L'extériorité du thème situationnel par rapport au contenu peut être précisée à l'aide de la distinction mode/contenu. Dans le cas de l'expérience sensible (perception, souvenir épisodique), c'est le mode qui détermine la situation relativement à laquelle le contenu doit être évalué. On montre que, au-delà de l'expérience sensible, la distinction mode/contenu s'applique aussi à la pensée.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Séminaire - Marie Guillot : La « foutaise » dans le débat public à la lumière de Frankfurt et d'Austin
Marie Guillot
Université Paris Nanterre
Résumé
La « foutaise », discutée en philosophie depuis le célèbre essai de Harry Frankfurt, « On Bullshit » (1986), est une façon particulière de saboter l'intégrité du discours qui prolifère dans certains contextes contemporains de parole politique. Pourquoi, dans ces contextes, est-il si difficile de mener des débats productifs ? L'analyse classique de Frankfurt n'offre que des ressources limitées pour le comprendre. Elle ignore les exemples de foutaise qui ne concernent pas des assertions mais d'autres actes de langage, ainsi que les cas où la foutaise, loin de se cacher, est manifeste, voire ostentatoire. Je défends une conception étendue et non assertorique de la foutaise qui permet de caractériser plus précisément ses différentes formes, et le dommage spécifique qu'elle inflige à l'exercice du débat public.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
04 - La structure des contenus mentaux : La structure informationnelle
Résumé
La structure informationnelle d'un énoncé, c'est la façon dont se distribuent, dans un énoncé, l'information déjà disponible rappelée ou présupposée par l'énoncé (le « thème »), et l'information nouvelle dont l'énoncé est porteur (le « propos »). On peut réinterpréter dans ce cadre théorique les idées de Brentano-Marty et de Strawson sur la structure du jugement. Un énoncé thétique est alors un énoncé dont le thème est externe au contenu du jugement et ne correspond pas à son sujet, ni à un autre élément de son contenu.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Séminaire - Filipe Drapeau Vieira Contim : Y a-t-il un tigre-étalon ?
Filipe Drapeau Vieira Contim
Université de Rennes 1, CAPHI EA 7463
Résumé
Les termes d'espèce naturelle (« Tigre », « Hêtre », « Or », etc.) font débat : s'agit-il de termes descriptifs qui exprimeraient des caractéristiques des objets tombant dans leur extension, ou fonctionnent-ils plutôt comme des noms qui désigneraient directement leur espèce, sans l'intermédiaire d'une description ? Selon la Théorie Causale de la Référence (TCR), un terme comme « Tigre » nomme directement l'espèce du Tigre grâce à l'ostension d'un échantillon de tigres individuels qui constitue l'étalon de référence pour les usages ultérieurs du terme. Je me propose ici de confronter la TCR à la pratique des noms de taxons telle qu'elle est réglée par le Code International de Nomenclature Zoologique. Je tâcherai de montrer qu'en dépit de contre-exemples avancés récemment, les prédictions de la TCR sont vérifiées par les noms scientifiques d'espèces et de sous-espèces.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
03 - La structure des contenus mentaux : Jugements thétiques et jugements catégoriques
Résumé
Brentano invoque les jugements à un seul terme (« il y a de la neige », « il pleut »), pour réfuter la conception aristotélicienne selon laquelle tout jugement a la structure sujet/prédicat. Les jugements à un seul terme affirment (ou nient) la réalité de quelque chose ; ce sont des jugements « thétiques ». Mais les jugements possédant la structure sujet/prédicat peuvent eux-mêmes se réduire à des jugements thétiques, affirmant ou niant la réalité d'un état de choses complexes. Dans un deuxième temps, Brentano, avec son disciple Marty, montre que les jugements thétiques en ce sens généralisé n'épuisent pas la gamme des jugements possibles. Il y a aussi des jugements « catégoriques » qui ont une structure double : ils présupposent l'existence de quelque chose dont ils affirment (ou nient) quelque chose. À nouveau on note une convergence sur ces points entre Brentano et Strawson.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Séminaire - Joëlle Proust : Existe-t-il une sémantique propre à la perception des affordances cognitives ? La piste du placement de traits
Joëlle Proust
CNRS
Résumé
Quand ils sont expérimentalement confrontés à des tâches de discrimination ou de remémoration, les primates non humains et les enfants pré-langagiers s'avèrent capables, avant de répondre, d'évaluer s'ils ont des chances de donner une réponse correcte. Ils peuvent aussi moduler leur décision en fonction des gains pragmatiques attendus. Dans tous ces cas, pourtant, les évaluations sont effectuées en l'absence de toute théorie du fonctionnement mental. Comment se représentent-ils les affordances cognitives et pragmatiques pertinentes pour leur décision ? Une piste de réponse est donnée par la sémantique préconceptuelle par « placement de traits dans l'espace » de Peter Strawson, (1959). Nous proposerons de la compléter par un indicateur d'intensité et un pointeur d'action, et de la généraliser au cas des traits non spatiaux que sont les sentiments métacognitifs.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
02 - La structure des contenus mentaux : Le jugement
Résumé
Dans la tradition aristotélicienne, le contenu d'un jugement fait intervenir deux termes : ce dont on parle (le sujet) et ce qu'on en dit (le prédicat). L'acte consistant à attribuer le prédicat au sujet est ce qui garantit l'unité du contenu. Cette conception soulève deux objections, sur lesquelles on reviendra dans la dernière séance : l'une à trait à la distinction de la force et du contenu ; l'autre a trait à l'existence de jugements « à un seul terme », sur lesquels Brentano, puis Strawson, ont mis l'accent.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
01 - La structure des contenus mentaux : Contenus de pensée
Résumé
Une pensée, au sens de Descartes et des Cartésiens, c'est un contenu de conscience, quel qu'il soit. Certains contenus de conscience sont « représentatifs » et possèdent un objet auxquels ils se rapportent. Parmi ceux-ci, on distingue ceux dont le contenu représentatif est simple et ceux dont le contenu représentatif est complexe (articulé). Parmi ces derniers, les jugements se distinguent par le fait de pouvoir être évalués comme vrais ou faux. Une pensée, au sens de Frege, est un contenu de jugement.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Colloque - The Social World: Foundational Issues - The Pure Commodity Theory of Money
Intervenant(s)
Olivier Massin, université de Neuchâtel
Résumé
"The paper defends the view that money is any continuant used as a medium of exchange, a view dubbed the pure commodity theory of money. By contrast to the standard commodity theory, which equates money with a material commodity which spontaneously ends up being used as a means of exchange, the pure commodity theory does not place any requirement on the origin or materiality of money. I then compare the pure commodity theory with four main rivals. On the credit theory, money is a kind of debt or claim; on the abstract theory, money is a position on a ratio scale. On the property theory, money is some property of an agent, namely the agent's purchasing power. On the institutional theory, money is a system of rules.
I argue that the credit theory and the abstract theory are in fact versions of the pure commodity theory, for claims and positions on ratio scale, properly understood, are continuants used as media of exchange. I argue that the property and the institutional theories are better construed not as theories about money, but as a theory about closely connected phenomena. The property theory is a theory about the purchasing power conferred by money. The institutional theory is a theory about what explains the existence and maintenance of money. One central strand is that there exists animportant category of exchangeable goods, intangible goods, the neglect of which leads to dismiss the commodity theory on poor grounds."
Olivier Massin est agrégé de philosophie et professeur à l'université de Neuchâtel. Ses recherches s'inscrivent dans le cadre de la métaphysique descriptive. Il s'intéresse à l'école brentanienne de philosophie et à des questions telles que : Qu'est-ce qu'une force ? Qu'un mélange ? Qu'un échange économique ? Que la propriété ? Qu'une montagne ? Que le toucher ? Qu'un désir ? Qu'une valeur ? Que le plaisir ? Que le continu ? Que l'optimisme ? Que la richesse ? Qu'un effort ? Que la solidité ? Que l'optimisme ? Que l'argent ? Qu'une fondue ?
Ce colloque international se tient en prélude à la soutenance de thèse de Maryam Ebrahimi Dinani, assistante de recherche du Pr Recanati. Il réunit deux des membres du jury (Kathrin Koslicki, de l'Université de Neuchâtel, et Manuel Garcia-Carpintero, de l'Université de Barcelone) et deux invités (Indrek Reiland, de l'Université de Vienne, et Olivier Massin, de l'Université de Neuchâtel), sous la présidence de Kevin Mulligan, de l'Université de Genève.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Colloque - The Social World: Foundational Issues - On the Mood for Fiction
Intervenant(s)
Manuel Garcia-Carpintero, université de Barcelone
Résumé
How should we think of the utterances that convey (literary) fictions? Searle (1974/5) (and before him MacDonald (1954), with better arguments) influentially argues that they are (non-deceptive) mere pretense – the simulation of acts like assertions or questions. They don't constitute sui generis, dedicated representational practices of a specific kind, fictionalizing, on a par with assertions or questions. This has been the standard view in analytic philosophy until the 1990s, casually endorsed already by Frege, and then by many others like Austin, Kripke and van Inwagen. Even though authors including Alward (2009), Predelli (2019, 2020), and Recanati (2021) still endorse the view, Walton (1990) and others provide in my view decisive objections (cf. in particular de Gaynesford 2009), mostly predicated on its lack of explanatory power for different aspects of fictionality that good theories should and can provide. Walton himself also rejects views of the kind MacDonald and Searle question, which take fictionalizing to be a sui generis speech act, but his arguments are uncompelling; Currie (1990) nicely articulated one such account inside a Gricean framework, showing its explanatory power. Recently other writers have argued that a more conventionalist, Austinian framework provides better accounts, including García-Carpintero (2013), Abell (2020) and Bergman & Franzén (2022). While following Currie I suggested classifying speech acts of fictionalizing as directives, the latter authors defend classifying them as declarations – like giving out players, naming ships or sentencing offenders. In my paper I'll question the declaration view, but I'll also explore another alternative to the directive account, by considering whether fictionalizings are a variety of constative act, along lines that Predelli (1997), Recanati (2000), and Reimer (2005) have theorized.
Manuel García-Carpintero a obtenu son doctorat à l'université de Barcelone, où il enseigne depuis. Il travaille dans le domaine de la philosophie du langage et de l'esprit, ainsi que sur des questions épistémologiques et métaphysiques connexes. Il termine actuellement un livre sous contrat avec Oxford University Press sur la nature des actes de langage en général et de l'assertion en particulier, intitulé Tell Me What You Know.
Ce colloque international se tient en prélude à la soutenance de thèse de Maryam Ebrahimi Dinani, assistante de recherche du Pr Recanati. Il réunit deux des membres du jury (Kathrin Koslicki, de l'Université de Neuchâtel, et Manuel Garcia-Carpintero, de l'Université de Barcelone) et deux invités (Indrek Reiland, de l'Université de Vienne, et Olivier Massin, de l'Université de Neuchâtel), sous la présidence de Kevin Mulligan, de l'Université de Genève.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Colloque - The Social World: Foundational Issues - Artifact Kinds, Functions, and Capacities
Intervenant(s)
Kathrin Koslicki, université de Neuchâtel
Résumé
In the case of some artifacts, the connection between the kind to which the artifact belongs, its function, and its capacities appears to be quite straightfoward. For example, a well-functioning can-opener belongs to the artifact-kind, can-opener, its function is to open cans, and being able to open cans is also among its capacities. This seemingly straightforward connection between artifact kinds, functions, and capacities, however, does not always obtain. A malfunctioning can-opener, for example, still belongs to the kind, can-opener, and can be said to have the function of opening cans, even though, in its current state, it seems to lack the corresponding capacity to open cans. In addition, while each artifact of course has many capacities, only some of these capacities are correlated with an artifact's function or its kind-membership. For example, the mere fact that an anvil can be used as a doorstop does not bring it about that the kind, anvil, is regarded as a subspecies of the kind, doorstop, or that anvils are taken to have the same function as doorstops. In this talk, I explore different ways of resolving such potential misalignments between artifact kinds, functions, and capacities.
Kathrin Koslicki
Kathrin Koslicki est professeure de philosophie théorique à l'Université de Neuchâtel. Pr Koslicki est originaire de Munich, en Allemagne, et a déménagé aux États-Unis pour obtenir son BA en philosophie à la SUNY Stony Brook en 1990 et son doctorat au MIT en 1995. Avant de retourner en Europe en 2020 pour rejoindre l'Institut de philosophie de l'Université de Neuchâtel, elle a occupé des postes de professeure dans de nombreuses régions des États-Unis et du Canada. Plus récemment, elle était titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 en épistémologie et métaphysique à l'Université de l'Alberta.
Les intérêts de recherche de la Pr Koslicki en philosophie se situent principalement dans les domaines de la métaphysique, la philosophie du langage et la philosophie grecque ancienne, en particulier Aristote. Dans ses deux livres (The Structure of Objects, Oxford University Press, 2008 ; et Form, Matter, Substance, Oxford University Press, 2018), elle défend une analyse néo-aristotélicienne d'objets particuliers concrets en tant que composés de matière (hulē) et de forme (morphē).
Ce colloque international se tient en prélude à la soutenance de thèse de Maryam Ebrahimi Dinani, assistante de recherche du Pr Recanati. Il réunit deux des membres du jury (Kathrin Koslicki, de l'Université de Neuchâtel, et Manuel Garcia-Carpintero, de l'Université de Barcelone) et deux invités (Indrek Reiland, de l'Université de Vienne, et Olivier Massin, de l'Université de Neuchâtel), sous la présidence de Kevin Mulligan, de l'Université de Genève.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2023-2024
Colloque - The Social World: Foundational Issues - What Is It to Accept a Rule?
Intervenant(s)
Indrek Reiland, université de Vienne
Résumé
Regulative rules like social and legal rules and constitutive rules of games and language are in force contingently, and due to human activity. On standard views like Reinach's or Hart's, for rules to be in force is either for a legislative authority to have enacted them or for people to accept them. But what kind of attitude is acceptance of a rule? In this talk I will start working towards an answer to this question by discussing constraints on possible answers and the merits and shortcomings of available views.
Indrek Reiland est titulaire d'une bourse postdoctorale Lise Meitner, à l'université de Vienne. Il a reçu son doctorat de l'université de Californie du Sud. Il est spécialisé dans le domaine de la philosophie du langage et de l'esprit et travaille sur la nature des règles sociales et le rôle qu'elles jouent dans la constitution des langues publiques. Ses travaux ont été publiés, entre autres, dans Analysis, Erkenntnis, Mind & Language, Philosophical Studies, Philosophy and Phenomenological Research et Synthese.
Ce colloque international se tient en prélude à la soutenance de thèse de Maryam Ebrahimi Dinani, assistante de recherche du Pr Recanati. Il réunit deux des membres du jury (Kathrin Koslicki, de l'Université de Neuchâtel, et Manuel Garcia-Carpintero, de l'Université de Barcelone) et deux invités (Indrek Reiland, de l'Université de Vienne, et Olivier Massin, de l'Université de Neuchâtel), sous la présidence de Kevin Mulligan, de l'Université de Genève.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2022-2023
La première personne
Conférencier invité - Hans Kamp : MSDRT and the Semantics of Fiction. More Philosophical Puzzles about Fictional and Other Empty and Non-empty Names
Professor of Formal Logics and Philosophy of Language, Institute for Natural Language Processing (IMS), University of Stuttgart
Much that we want to say to others, or express for the clarification of our own minds, is better said in several sentences than in a single one. There is too much we want to say that can be comfortably expressed in a single sentence; such a sentence would be far too long to be readily understood and often also too long even for us to produce without losing track of its grammar. Our languages are well-equipped for such multi-sentence communications of complex thoughts, with rules for how what is contributed by the next sentence must be integrated into the content obtained from the preceding sentences. Here is one illustration:
(1) Fred has bought his daughter a donkey. She doesn't like it much.
The two sentences of (1) are related in more ways than one. Among these are the connections established by the pronouns she and it with their antecedents his daughter and a donkey. Because of these connections, the two sentences together express the single proposition that there is a donkey that Fred has bought for his daughter and that his daughter doesn't much like. One important task for the linguist is to understand how sentence-connecting devices like pronouns work. The framework of DRT ("Discourse Representation Theory", Kamp (1981,a,b)) was set up to study such devices.
- Vis mere