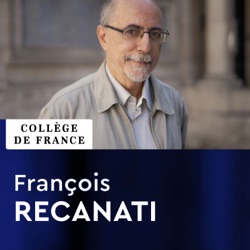Episodit
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Séminaire - Anna Marmodoro : L'ontologie des particuliers individuels («individual particulars»)
Intervenant(s) :
Anna Marmodoro
Résumé :
Peter Strawson a affirmé que chaque objet de notre expérience quotidienne est un en tant que particulier individuel (« individual particular »). Cependant, pourquoi quelque chose serait-il un, s'il est individuel et également particulier ? Je soutiens qu'être individuel et être particulier introduisent deux manières différentes d'être un ; la première est descriptive (par exemple « humain »), tandis que la seconde est indexicale (« ceci »). Et pourtant, chaque objet est un ! Comment cela est-il possible ? Je soutiens qu'Aristote, lui aussi, a pensé qu'un objet est un particulier individuel, mais il a soutenu qu'en outre, l'unité de l'objet nécessite une justification métaphysique. La solution d'Aristote est que l'individu est le sujet de la particularité, qui le qualifie comme particulier. Je suggère en outre la possibilité de développer une solution inverse à celle d'Aristote, selon laquelle le particulier est le sujet de l'individualité, qui le qualifie comme individu. Pour ce faire, je m'appuie sur la « métaphysique indexicale » (non aristotélicienne et anti-descriptiviste) de Michael Ayers.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
06 - La dynamique cognitive - La norme strawsonienne et les concepts indexicaux
Intervenant(s) :
François Recanati
Professeur du Collège de France - Philosophie du langage et de l'esprit
Résumé :
Selon une seconde hypothèse, la relation R qui fait de deux concepts privés (les dossiers mentaux de deux individus distincts) des instances du même concept partagé est tout simplement le fait que les deux dossiers se rapportent à la même chose. Cette hypothèse « référentialiste », que nous avons rejetée comme principe d'individualisation des concepts privés, se révèle beaucoup plus acceptable si on l'applique aux concepts partagés. Selon cette hypothèse, il suffit, pour que deux sujets distincts puissent être dits partager un concept, que chacun de ces sujets possède un concept (un dossier mental) quelconque se rapportant à la même chose que celui de l'autre. Ou plus exactement : cela suffit dans les cas normaux.
Les cas normaux sont ceux où ce que j'appelle la norme strawsonienne est respectée. La norme strawsonienne demande qu'il y ait une correspondance bi-univoque entre les entités de l'environnement que le sujet se représente, et les dossiers mentaux au moyen desquels il se les représente. Elle implique que, quelle que soit l'entité représentée, un sujet rationnel doit se représenter cette entité à travers un et un seul dossier mental. Lorsque la norme strawsonienne n'est pas respectée par l'un des sujets candidats au partage conceptuel, le fait que les dossiers mentaux en jeu soient coréférentiels ne suffit plus à garantir le partage. Une condition supplémentaire doit alors être remplie : il faut que le contenu des concepts soit suffisamment semblable dans les deux cas.
La norme strawsonienne, toutefois, n'est pas universellement acceptée. Il y a une conception rivale que j'ai moi-même défendue dans le passé et selon laquelle, lorsqu'un sujet se rend compte que deux dossiers mentaux coréfèrent, il doit non pas fusionner les deux dossiers mais les « lier » de façon que l'information puisse circuler librement entre eux. L'existence d'une pluralité de dossiers coréférentiels n'est pas forcément une erreur, selon cette conception rivale, mais peut traduire simplement le fait que l'objet unique auquel les dossiers en question font référence nous apparaît sous des perspectives distinctes qui sont tout autant légitimes l'une que l'autre. Les concepts indexicaux incorporent de telles perspectives contextuellement changeantes. Les dossiers mentaux correspondants, parce qu'ils sont fondés sur une certaine relation contextuelle à l'objet, sont des dossiers temporaires qui ne sont disponibles pour penser à un objet que tant que nous sommes dans cette relation avec lui. Quand la relation change (quand le contexte change), nous devons recourir à un autre dossier mental pour continuer de penser à l'objet.
Mais, comme beaucoup d'auteurs l'ont souligné, le changement de perspective sur l'objet qui se traduit par le remplacement d'une expression indexicale (« aujourd'hui ») par une autre (« hier ») n'affecte pas plus la stabilité du concept sous-jacent que ne le fait le changement de conception. Contrairement à ce que je soutenais antérieurement, la perspective indexicale n'entre pas en ligne de compte dans l'individualisation du concept, identifié au dossier mince. Elle relève du dossier épais, tout comme la conception. Or ce que la norme strawsonienne proscrit, à juste titre, c'est l'existence simultanée d'une pluralité de dossiers minces se rapportant au même objet.
-
Puuttuva jakso?
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Séminaire - Maryam Ebrahimi Dinani : Les actes communicatifs en deuxième personne. Les leçons de Reinach et Reid
Intervenant(s) :
Maryam Ebrahimi Dinani
Résumé :
Dans « Intention and Convention in Speech Acts », Strawson a soutenu de manière influente une distinction entre les actes essentiellement conventionnels et les actes communicatifs : les actes conventionnels reposent sur des conventions extralinguistiques pour leur exécution réussie ; les actes communicatifs n'en dépendent pas. En m'inspirant des conceptions des actes sociaux d'Adolf Reinach (1913) et de Thomas Reid (1785), je propose d'introduire une distinction au sein de la catégorie des actes communicatifs/non conventionnels, entre ceux qui sont essentiellement sociaux ou en deuxième personne (second-personal) et ceux qui ne le sont pas. Ces derniers ne requièrent pas d'assurer la réception pour être réussis ; les premiers, en revanche, dépendent d'attitudes conjointes (joint attitudes) pour leur réalisation. J'adopterai le concept d'actes communicatifs en deuxième personne comme catégorie fondamentale dans la classification des actes illocutoires et mettrai en évidence les bénéfices qu'il y a à fonder cette classification sur les aspects en deuxième personne de la communication.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
05 - La dynamique cognitive - Les dossiers mentaux comme « continuants »
Intervenant(s) :
François Recanati
Professeur du Collège de France - Philosophie du langage et de l'esprit
Résumé :
Selon la perspective « véhiculariste », deux concepts coréférentiels sont le même concept si et seulement si le véhicule (le dossier mental mince) est le même. La conception (le contenu du concept) peut varier, cela n'affecte pas l'identité du concept, car celui-ci est individualisé non par le contenu mais par le véhicule. Reste à dire comment, dans cette perspective, on individualise les dossiers mentaux eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait que deux dossiers mentaux coréférentiels sont le même ou qu'ils sont différents ? On ne peut évidemment pas répondre à cette question en invoquant la référence ou la conception véhiculée, car ce serait un retour aux modes d'individualisation du concept qui ont été précédemment rejetés.
En tant que véhicule, le dossier mental mince est un « continuant » : un particulier qui persiste à travers le temps, et notamment à travers la variation des conceptions que le dossier véhicule à différents moments. Une thèse répandue concernant l'individualisation des particuliers invoque l'origine : deux particuliers sont le même s'ils ont la même origine. S'inspirant de Sainsbury et Tye (2012), on peut adapter cette conception au cas des dossiers mentaux, et soutenir qu'un dossier mental est individualisé par l'événement cognitif qui préside à l'ouverture de ce dossier.
Reste que les concepts (et les pensées qui sont des assemblages de concepts) peuvent être partagés entre différents individus. Il n'y aurait pas d'accord ou de désaccord possible entre différents sujets si ce n'était pas le cas. C'est la raison pour laquelle Sainsbury et Tye soutiennent (comme le faisait Frege et comme le font la plupart des philosophes) que les concepts sont une réalité supra-individuelle. Je propose quant à moi d'inverser la terminologie et d'appeler concept plutôt la réalité psychologique de base, c'est-à-dire le dossier mental, individualisé par son origine dans la vie mentale du sujet. Les concepts dans cette perspective ne peuvent être partagés, puisqu'ils appartiennent à la vie mentale d'un individu particulier. Mais on peut définir une notion de « concept partagé » comme classe d'équivalence de concepts privés. Deux concepts privés distincts font partie d'une telle classe d'équivalence, et sont donc des instances d'un seul et même concept partagé, lorsqu'il y a entre eux une certaine relation R, à définir.
Une première théorie possible définit la relation R comme l'appartenance à un même réseau de dossiers mentaux interconnectés grâce à un mot du langage public. Cette façon de concevoir la relation R a certains avantages, mais elle se heurte à une objection majeure : il n'est pas nécessaire de partager un langage pour partager un concept. Dans le cours suivant, d'autres façons de concevoir la relation R sont donc envisagées.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Séminaire - Pierre Jacob : Le syllogisme disjonctif et la mentalisation
Intervenant(s) :
Pierre Jacob
Professeur philosophe
Résumé :
La capacité d'attribuer des croyances à autrui (la mentalisation) et la capacité d'effectuer un syllogisme disjonctif partagent un point commun. Pour croire que [Sally croit que p], il faut être capable de penser p sans juger que p est vraie. Pour croire que [p ou q], il faut être capable de penser p et de penser q sans juger que p est vraie et q est vraie. La double investigation de l'ontogénèse des capacités d'attribuer des croyances à autrui et d'effectuer un syllogisme disjonctif chez les enfants humains par la psychologie du développement a engendré des résultats expérimentaux discordants, sinon contradictoires, qu'il convient de réconcilier. Les résultats divergent selon que les tests utilisés sont verbaux ou non verbaux. Je propose de réconcilier les résultats (i) en admettant la distinction philosophique entre la force judicative et le contenu propositionnel jugé ; (ii) en supposant que les résultats des tests non verbaux sont des indices fiables d'une capacité cognitive ; (iii) en explorant les défis pragmatiques inhérents aux tests verbaux.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
04 - La dynamique cognitive - Concept et mode de présentation
Intervenant(s) :
François Recanati
Professeur du Collège de France - Philosophie du langage et de l'esprit
Résumé :
Dans un cas frégéen, un sujet rationnel peut croire qu'une certaine entité possède la propriété F, et, dans le même temps, refuser de croire que cette même entité possède la propriété F. Il s'ensuit que les concepts, les constituants des pensées, ne sont pas individualisés par leur référence. L'argument de Frege en faveur de cette conclusion peut se résumer de la façon suivante : on ne peut pas individualiser les concepts par leur référence, car si on le pouvait, l'identité de référence impliquerait, dans les cas frégéens, l'identité des concepts, et l'identité des concepts entraînerait à son tour l'identité des pensées, et donc la violation de la contrainte cognitive selon laquelle un sujet rationnel ne peut simultanément adopter des attitudes contradictoires (l'acceptation et le rejet) vis-à-vis de la même pensée.
Selon Frege, les concepts ne sont pas individualisés par leur seule référence mais par la référence plus autre chose, que Frege nomme le mode de présentation. De quoi s'agit-il exactement ? Dans tous les exemples de cas frégéens, le sujet dispose de deux dossiers mentaux distincts se rapportant à la même entité (sans se rendre compte qu'il s'agit de la même entité). Cela suggère que le quelque chose en plus, jouant le rôle de mode de présentation, c'est le dossier mental : si l'on change le dossier mental, on change le concept, même si la référence est la même.
Mais il y a une ambiguïté dans cette notion de dossier mental. Dans le cours précédent, j'ai proposé de distinguer deux choses : le dossier en tant que tel – que l'on peut appeler le véhicule – et la conception qui est le contenu du dossier. Cette distinction révèle l'ambiguïté dont je parle : on peut entendre, par dossier mental, soit le dossier en tant que tel, indépendamment du contenu qu'il véhicule (le dossier « mince »), soit le dossier pourvu d'un certain contenu (c'est-à-dire l'ensemble véhicule + contenu, que j'appelle le dossier « épais »). Cette distinction étant posée, on montre que ce qui joue le rôle de mode de présentation, c'est le dossier mental épais, et non le dossier mental mince. Cette conclusion est-elle compatible avec l'idée que le contenu d'un concept (la conception) n'est pas constitutif de celui-ci et ne sert pas à l'individualiser ? Oui, à condition de distinguer le concept (identifié au dossier mental mince) et le mode de présentation (identifié au dossier mental épais et intégrant la conception). Le mode de présentation, dans cette perspective, c'est une phase, ou tranche temporelle, du concept, phase caractérisée entre autres choses par la conception véhiculée par le concept au moment dont il s'agit.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Séminaire - Bruno Langlet : À quoi l'on pense. Pertinence et difficultés de la théorie meinongienne des attitudes assomptives
Intervenant(s) :
Bruno Langlet
Université Bordeaux-Montaigne
Résumé :
Les attitudes assomptives théorisées par Meinong sont des attitudes mentales portant sur des états de choses, factuels ou non, qu'elles qualifient positivement ou négativement, mais sans impliquer, à leur propos, le type de conviction caractéristique des jugements et des croyances. La supposition, la considération, la simulation, les variétés de l'imagination, la réflexion en termes de conditionnels contrefactuels, la présomption peut-être, ou encore la contemplation, la formation d'hypothèses, la construction de modèles, celle d'expériences de pensée, entre autres possibilités, mais aussi certaines formes du sentiment, comme celles impliquées dans des scènes de fiction ou dans la motivation du désir, semblent entretenir une certaine parenté avec les assomptions meinongiennes, voire en être des cas. Leurs relations sont toutefois à clarifier, car c'est peut-être justement trop demander à ce type d'acte mental, ou le mécomprendre, que de le considérer comme un ingrédient commun à toutes ces manières de penser. Meinong attribuait certes une très large portée à l'assomption, mais affirmait surtout, contre les positions de ses contemporains (Brentano, Marty, Husserl, Russell), qu'une place devait lui être ménagée, en tant qu'attitude mentale authentique, aux côtés des représentations, des jugements, des sentiments et des désirs. Il la considérait comme essentielle à nombre d'activités ordinaires, ainsi qu'à celles qui sont plus complexes cognitivement et intellectuellement parlant, et la tenait surtout pour un mode fondamental et décisif du rapport entre l'esprit et ses divers objets, inéliminable, mais le plus souvent mal compris ou ignoré. Il lui faisait revêtir un caractère décisif pour la théorie de l'appréhension des objets de pensée et son articulation avec la psychologie, la théorie de la connaissance, et la théorie de l'objet. Nous reviendrons sur ces points et essaierons de montrer comment cette perspective meinongienne peut se rapporter à certains débats contemporains.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
03 - La dynamique cognitive - La thèse référentialiste
Intervenant(s) :
François Recanati
Professeur du Collège de France - Philosophie du langage et de l'esprit
Résumé :
Qu'est-ce qui fait d'un concept le concept qu'il est ? Qu'est-ce qui distingue, par exemple, mon concept de tigre de mon concept de chat ? Est-ce ce à quoi le concept se rapporte ou bien est-ce la conception que s'en fait le sujet ? Selon la thèse référentialiste, la première réponse est la bonne. Certes, ces deux choses, la référence et la conception, vont normalement de pair. Mon concept de tigre se rapporte aux tigres ET, pour cette raison même, son contenu inclut les caractéristiques des tigres : les différences objectives, au niveau de la référence du concept, entre les tigres et les chats se reflètent dans les conceptions associées respectivement à ces deux concepts. Mais s'il est vrai que les deux choses – la référence et la conception – vont normalement de pair, elles peuvent ne pas s'accorder, dans la mesure où la conception peut être erronée, voire massivement erronée. Il en va ainsi dans l'exemple des chats-robots évoqué dans le premier cours. Ce type d'exemple suggère que le concept est individualisé par sa référence, déterminée par des facteurs environnementaux, et non par la conception que s'en fait le sujet qui déploie le concept.
L'intérêt du point de vue référentialiste, selon lequel un concept est individualisé par sa référence, est de garantir la stabilité du concept en dépit de la variabilité du contenu. On illustre cette stabilité à partir d'un exemple bien connu, issu des travaux de Tyler Burge : l'exemple du concept d'arthrite qu'un patient ignorant hérite de son médecin malgré la différence radicale de leurs conceptions respectives.
La thèse référentialiste implique qu'il ne peut y avoir deux concepts distincts se rapportant à la même chose (puisque le fait de se rapporter à la même chose ferait automatiquement de ces concepts le même concept). Or, la possibilité d'une pluralité de concepts-types distincts se rapportant à la même chose est une des affirmations bien connues de Gottlob Frege. Pour rendre compte des exemples invoqués par Frege (les « cas frégéens » dont j'ai parlé en détail dans mes cours de 2019 à 2021), on peut tenter de relativiser la thèse selon laquelle il ne peut y avoir deux concepts-types distincts se rapportant à la même chose. Cette thèse s'appliquerait seulement aux concepts « atomiques », qui seraient bien individualisés par leur référence, contrairement aux concepts composés qui sont individualisés par leurs constituants et la façon dont ils sont combinés. Mais la thèse référentialiste ne peut être maintenue, même sous cette forme limitée : il est en effet facile de produire des exemples de concepts atomiques distincts se rapportant à la même chose. L'existence de cas de ce type montre qu'on ne peut individualiser les concepts par leur seule référence : ce que Frege appelle le mode de présentation compte aussi.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Séminaire - Philippe Lusson : Savoir ce que l'on veut : raison pratique et épistémologie du désir
Intervenant(s) :
Philippe Lusson
Résumé :
Deux traits distincts semblent caractériser le désir. D'une part, le désir motive des actions dirigées vers son objet. D'autre part, désirer un objet semble vouloir dire y prendre plaisir ou l'apprécier. Les théories du désir se divisent sur l'aspect essentiel à retenir ou cherchent à les identifier plus étroitement qu'il n'y paraît. Je m'appuierai sur l'acquisition de désirs par l'expérience pour soutenir que le désir est en réalité un état mental complexe aux deux aspects distincts et parfois discordants. Il en résulte pour l'agent une opacité de certaines propriétés importantes du désir et un obstacle à la satisfaction de ses désirs. Je tâcherai de montrer que les propositions les plus courantes pour caractériser l'épistémologie du désir ne permettent pas de surmonter cet obstacle. Je proposerai une théorie du travail d'élucidation du désir qui donne un rôle important à une forme de raisonnement pratique et aux croyances évaluatives et j'envisagerai diverses manières dont ces dernières peuvent guider les actes exploratoires parfois nécessaires pour percer l'opacité du désir.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
02 - La dynamique cognitive - Concept et conception
Intervenant(s) :
François Recanati
Professeur du Collège de France - Philosophie du langage et de l'esprit
Résumé :
Dans la représentation à laquelle nous aboutissons, les concepts sont comme des « nœuds » dans un réseau conceptuel, et les relations entre les nœuds représentent non seulement les implications analytiques des concepts – le fait que le rouge soit une couleur, ou que les célibataires soient non mariés – mais aussi les liaisons contingentes qui s'établissent entre concepts au niveau du savoir encyclopédique – le fait que les tomates mûres soient rouges, et les célibataires moins casaniers que les gens mariés, par exemple.
Si l'on met dans le contenu d'un concept tout ce que nous savons ou croyons savoir concernant les objets qui tombent sous le concept, et si l'on maintient l'idée que le contenu d'un concept est ce qui fait qu'il est le concept qu'il est, alors on doit accepter qu'à chaque fois qu'une modification de notre savoir encyclopédique sur les objets en question survient, on change de concept – un concept est substitué à un autre. Cette conséquence est inacceptable, car elle met en danger une propriété fondamentale des concepts : leur stabilité.
En tant que constituants des pensées, les concepts sont essentiellement combinables. Parce qu'ils sont essentiellement combinables, les concepts doivent être répétables : le même concept doit pouvoir apparaître dans plusieurs pensées distinctes, combiné avec divers autres concepts. Cette répétabilité du concept est exploitée dans le raisonnement, tant théorique que pratique. Un concept doit rester le même aussi d'un sujet à l'autre pour qu'il puisse y avoir discussion rationnelle et accord ou désaccord : le désaccord entre deux personnes implique un partage des pensées (pour une seule et même pensée, un sujet la tient pour vraie et l'accepte, alors que l'autre la rejette), et donc la stabilité interpersonnelle des concepts qui sont les constituants de ces pensées. De la même façon, le changement d'avis d'une seule et même personne requiert le partage des pensées, et donc des concepts, entre la personne qui juge aujourd'hui que P et la personne qu'elle a été antérieurement et qui, elle, jugeait que non P.
Pour sauvegarder la stabilité, tant intra- qu'interpersonnelle, des concepts, tout en maintenant la conception encyclopédique du contenu des concepts, il faut renoncer à l'idée que le contenu d'un concept est ce qui fait qu'il est le concept qu'il est. Il faut distinguer le concept et le contenu du concept (la « conception »). Le concept est indépendant de la conception, au sens où la conception peut changer, même radicalement, sans qu'on cesse pour autant de déployer le même concept. Lorsque nous changeons d'avis sur un sujet donné, notre conception change, mais le concept reste stable. Cela signifie que l'identité d'un concept n'est pas fonction de son contenu, mais d'autre chose. De quelle autre chose s'agit-il ?
Selon la thèse « référentialiste », ce qui permet d'individualiser un concept, ce qui en fait le concept qu'il est, ce n'est pas le contenu du concept mais sa référence, c'est-à-dire ce dont le concept est le concept. Deux concepts sont le même si et seulement s'ils se rapportent à la même chose.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Séminaire - Pascal Ludwig : Le langage de la perception et l'expérience consciente
Intervenant(s) :
Pascal Ludwig
Université Paris-Sorbonne
Résumé :
Selon l'approche « naïve » de la perception, avoir une expérience sensorielle consciente implique d'entretenir une certaine relation avec l'environnement. Ainsi, le caractère qualitatif d'une expérience visuelle de rouge ne provient pas d'un « quale » interne à l'esprit, mais plutôt d'une relation avec une instanciation réelle de la couleur rouge dans la scène perçue. Cette approche est notamment motivée par l'étude du langage de la perception, puisqu'en français, nous décrivons les événements de perception comme des relations entre des sujets et des entités réellement présentes dans l'environnement. Je me propose de défendre cette approche relationnelle naïve, en la confrontant à certains usages du vocabulaire de la perception qui pourraient sembler la contredire, en particulier dans les situations de perception anormale.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
01 - La dynamique cognitive - Le contenu des concepts
Intervenant(s) :
François Recanati
Professeur du Collège de France - Philosophie du langage et de l'esprit
Résumé :
Selon la conception classique, le contenu d'un concept est la définition qui lui est associée. Maîtriser ou posséder un concept c'est avoir la connaissance, au moins tacite, de la définition en question. Ainsi entendu le contenu d'un concept détermine son extension (tombe sous le concept tout ce qui satisfait la définition), mais il permet aussi d'individualiser le concept, c'est-à-dire à le distinguer des autres concepts (si on change la définition on change automatiquement le concept).
Il y a deux variantes de cette théorie, et les deux se heurtent à un problème. 1re variante : à travers les définitions qui leur sont associées, les concepts se renvoient les uns aux autres de façon plus ou moins circulaire, comme un dictionnaire qui définit A en termes de B, B en termes de C, et C en termes de A. Problème : on ne sait pas très bien, dans cette version holistique de la théorie, comment l'on sort du système des concepts (qui fonctionne pour ainsi dire en circuit fermé) pour ancrer ce dernier dans la réalité que les concepts sont censés représenter. 2e variante : Certains concepts sont définis en termes d'autres concepts qui peuvent eux-mêmes être définis en termes d'autres concepts encore, mais au bout de la chaîne on trouve des concepts qui ne sont pas eux-mêmes définis à partir d'autres concepts (et au niveau desquels se fait l'ancrage du système). Problème : puisque ces concepts n'ont pas de définition, la conception classique leur est inapplicable, et on est inéluctablement conduit à rechercher une conception de rechange.
Dans la conception qui a remplacé la conception classique, et qui a été élaborée sous diverses formes par les philosophes et les psychologues (théorie du stéréotype, théorie des prototypes, théorie des exemplaires…), le contenu d'un concept n'est pas une définition, c'est-à-dire un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes pour que quelque chose tombe sous le concept, mais une représentation souvent contingente et superficielle de la réalité à laquelle se rapporte le concept. Une telle représentation permet d'identifier dans la plupart des cas les instances du concept dans l'environnement, mais en exploitant des faits contingents de sorte que la représentation, contrairement à une définition en bonne et due forme, ne livre pas des conditions nécessaires et suffisantes pour l'application du concept.
La thèse selon laquelle le contenu d'un concept inclut du savoir empirique sur les choses qui tombent sous le concept implique le rejet de la thèse selon laquelle le contenu d'un concept détermine son extension. Loin de déterminer l'extension, c'est le contenu du concept qui est dans une large mesure fonction des propriétés factuelles des choses qui tombent sous le concept. Le contenu des concepts ressemble, sous cet aspect, aux notions qu'on associe aux noms propres. En s'appuyant sur cette analogie avec les noms propres, on peut décider d'inclure dans le contenu d'un concept non seulement le « stéréotype » (les propriétés typiques des choses qui instancient le concept) mais aussi la totalité du savoir encyclopédique sur ces choses. Un concept est alors conçu comme un dossier mental incluant tout ce que l'on sait ou croit savoir de la réalité à laquelle renvoie le concept.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Conférence - David Papineau - Thoughts and Things : Confusions about Consciousness
David Papineau
Département de philosophie, King's College London
Résumé :
Many of the above ideas found their first clear expression over half a century ago in Kripke's Naming and Necessity. Kripke's work, however, has been misappropriated by many of his interpreters.
This applies particularly to Kripke's anti-materialist challenge at the end of Naming and Necessity. Many read this implicitly endorsing the "two-dimensional semantics" thesis that any term that is not epistemically revelatory must have a semantic content additional to its referent. I shall show that this thesis is not only misguided and but also quite unfaithful to Kripke's intentions. This will allow me to properly explore the options open to the materialist in responding to Kripke's challenge.
Finally I shall relate Kripke's work to the idea with which I started, that the purpose of cognition is to lock on to predictable worldly items, and use this to make sense of Kripke's thinking about metaphysical modality.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Conférence - David Papineau - Thoughts and Things : Indexicality
David Papineau
Département de philosophie, King's College London
Résumé :
Are not many thoughts essentially indexical, in a way that adds a distinctive mode of presentation to their referential content?
We need to be careful, however, not to infer the indexicality of thoughts too quickly from the indexicality of their linguistic expression. While linguistic indexicality is common, for understandable reasons, nearly of the thoughts so expressed are name-like rather than character-like. I shall argue that even "perceptually, and spatiotemporally, demonstrative" thoughts are best modelled by the (often temporary) creation of name-like files.
The only definite role for character-like thoughts is at the interface between cognition and basic actions. The action-production system identifies objects and places using repeatable character-like referring terms. But precisely because these terms are repeatable they play no lasting role in thought.
By properly understanding the guidance of basic actions, we can both dissolve the so-called "interface problem" and cast light on the nature of conscious sensory experience.
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Colloque - The Limits of Fiction
Fiction and Non-fiction: The Borderlands
Intervenant(s) :
Stacie Friend
Birkbeck, University of London
-
François Recanati
Philosophie du langage et de l'esprit
Collège de France
Année 2024-2025
Colloque - The Limits of Fiction
Fictional Periphery and the Status of Nondiegetic Music and Extradiegetic Narrators
Intervenant(s) :
Mario Slugan
Queen Mary University of London
- Näytä enemmän